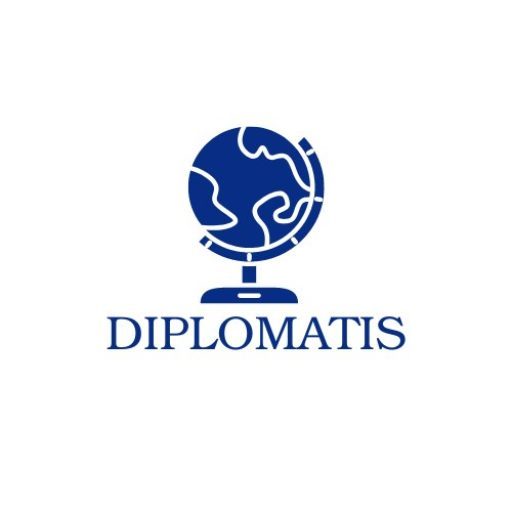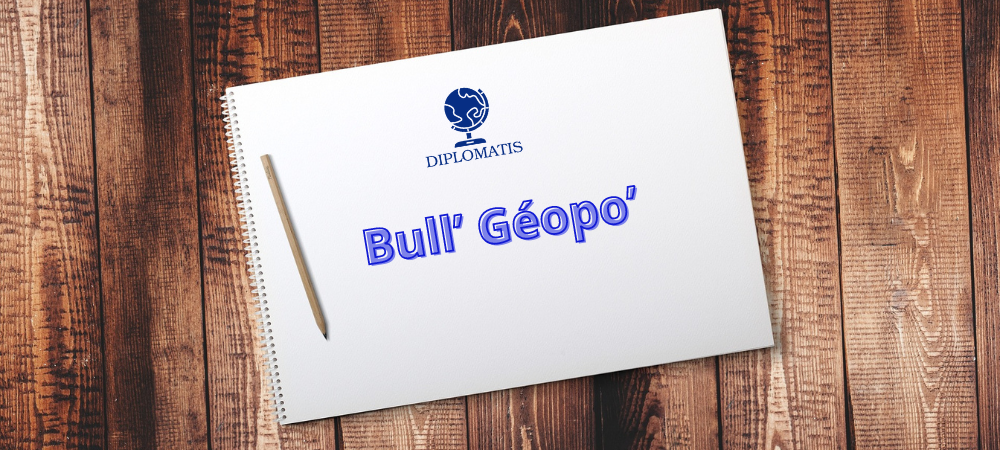De manière bimensuelle, le dimanche, Diplomatis vous propose son Bull’ Géopo, un bulletin synthétique regroupant les principales informations qui se sont déroulées au sein des relations internationales, durant les deux semaines qui viennent de s’écouler.
Table of Contents
ToggleImbroglio électoral au Sénégal.

Non-candidat à la prochaine élection présidentielle, alors qu’il arrive au terme de son second mandat, Macky Sall annonça, le samedi 3 février, le report sine die de l’élection présidentielle sénégalaise qui devait initialement se tenir le 25 février. En effet, par l’abrogation du décret fixant les modalités du scrutin, le Président Sall fait vivre au Sénégal son premier report, à une élection présidentielle au suffrage universel direct depuis 1963.
Le 5 février 2024, un projet de loi, validant le report de l’élection, est votée par l’Assemblée nationale, dans une atmosphère électrique où la Gendarmerie sénégalaise a dû évacuer des députés de l’opposition. Ces derniers demandant un débat puisqu’ils considèrent le fond du texte inconstitutionnel. L’adoption de ce texte, fixant une nouvelle date au 15 décembre 2024 (et la prorogation du mandat du Président Sall jusqu’à celle-ci) s’est déroulé sans opposition et plongeant le Sénégal dans la crise.
A partir du 10 février, des manifestations essaiment dans tout le pays, et entrainent une réaction des autorités provoquant la mort de trois jeunes hommes.
Les réactions internationales s’inquiète de cette situation. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) « exprime son inquiétude face aux circonstances qui ont conduit au report de l’élection et appelle les autorités compétentes à favoriser les procédures afin de fixer une nouvelle date« . Quant à la France, par le biais d’un communiqué du ministère des Affaires Etrangères, demande au Sénégal de « à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai possible et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise ».
Enfin, le Conseil constitutionnel sénégalais, dans une décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024, déclare que la loi, votée le 5 février 2024, est « contraire à la Constitution » et considère que « le processus électoral doit se poursuivre« . Néanmoins, les sept juges déclarent qu’il est « impossible » que le scrutin se tienne bien à la date initialement prévu du 25 février. Le Conseil demandant aux autorités d’organiser un scrutin « dès que possible« .
Signature d'accords de sécurité entre la France, l'Allemagne et l'Ukraine.

Par une tournée de deux jours chez ses alliés européens que sont l’Allemagne et la France, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaitait obtenir une sécurisation des aides concernant le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie.
A quelques jours de l’anniversaire du commencement de l’invasion par son voisin, le 24 février 2022, la première conclusion d’un accord s’est déroulée en Allemagne. Cette dernière aidera l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » comme l’a annoncé le Chancelier Olaf Scholz. Cela inclut près d’un milliards d’euros d’aides, dont des missiles Iris-T. Il s’agit d’une aide conséquente venant s’ajouter aux aides déjà prévues par l’Allemagne.
Dans la continuité du sommet de l’Otan, à Vilnius en juillet 2023, dont l’un des engagements était de fournir une aide à « long terme » à l’Ukraine, la France rejoint sa voisine pour conclure un accord de sécurité. Au total, il s’agira d’une enveloppe d’aides militaires de trois milliards d’euros, pour l’année 2024, qui viennent s’ajouter aux 1,2 milliards de 2022 et 2,1 milliards de 2023. Dans les faits, les aides incluent : la fourniture de matériel militaire, coopération entre les industries de défense, formation, renseignement, aide civile, etc… « En aidant nos partenaires ukrainiens, à se défendre, nous investissons pour la sécurité de l’Europe » a déclaré le Président Macron, le vendredi 16 février 2024.
Ces deux accords souhaitent lancer un signal, dans la continuité de celui signé entre le Royaume-Unis et l’Ukraine en janvier 2024, dans une perspective où le retour de Donald Trump, à la Présidence américaine, n’est plus à exclure. Lequel possède une relative désapprobation à l’égard des aides consacrées à l’Ukraine.
Mort de l'opposant russe Alexeï Navalny.

L’avocat, et militant anti-corruption, Alexeï Navalny est décédé, le vendredi 16 février 2024, au sein de la colonie pénitentiaire n°3 de Kharp (située à 3 000 km de Moscou, et 60 km du cercle polaire arctique).
Fondateur de l’ONG « Fondation Anticorruption » (FBK), Alexeï Navalny a été l’un des principaux opposants politiques du Président russe Vladimir Poutine. Suivi par des millions de personnes, via sa chaine YouTube ou ses réseaux sociaux, Alexeï Navalny fut victime d’une tentative d’empoisonnement par Novitchok, à laquelle il survivra difficilement (maintenu pendant un mois sous coma artificiel). Malgré la menace pour sa vie, il décide de revenir dans son pays natal. Alexeï Navalny sera arrêté, dès son retour, et condamné au cours de différents procès à des peines d’emprisonnement (la plus importante est rendue mi-juillet 2023 et culmine à 19 ans de prison pour « extrémisme »).
Les réactions internationales, nombreuses, partagent colère et tristesse. Le Président français Emmanuel Macron, « salue la mémoire d’Alexeï Navalny » en soulignant sa « colère et son indignation ». Pour le Chancelier allemand Olaf Scholz, l’opposant russe « a payé son courage de sa vie ». Beaucoup plus offensif à l’égard du régime russe, le Président américain accuse le Vladimir Poutine d’être responsable de la mort d’Alexeï Navalny, tout comme les dirigeants des Etats baltes. Le Président letton Edgars Rinkēvičs déclare que le fondateur du FBK « vient d’être brutalement assassiné par le Kremlin. C’est un fait et c’est quelque chose qu’il faut savoir sur la vraie nature du régime russe actuel ».
Victoire des proches d'Imre Khan au Pakistan.

Malgré le fait qu’il soit actuellement en prison, l’ancien Premier Ministre du Pakistan, entre 2018 et 2022, Imran Khan, fut l’un des principaux acteurs de des élections législatives pakistanaises.
Le PTI, parti d’Imran Khan, ne pouvant pas se présenter; les soutiens de l’ancien Premier Ministre se sont donc présenté sous la bannière de candidats indépendants. Et, dans la surprise générale, le « courant Khan » remporte l’élection avec 102 des 265 sièges. Cette victoire traduit un camouflet pour l’armée, qui soutenait pourtant le candidat Shehbaz Sharif (également ancien Premier Ministre).
Les autorités, rallongeant le temps de dépouillement, provoquent la réaction de manifestant pro-Imran Khan (qui conduit au décès de deux d’entre-eux dans le district de Shangla). En effet, cette lenteur, dans la publication des résultats, a renforcé l’idée, chez les électeur d’Imran Khan, que l’élection était en passe de leur être volée. Une volonté d’exclure le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) risque de mener le Pakistan Muslim League-Nawaz (PLM-N) et le Pakistan People’s Party (PPP) (représentant les deux deux dynasties les plus puissantes du pays : les Bhutto et les Sharif) a conclure un accord de gouvernement.
Sur le plan international, le Royaume-Unis, par le biais de son ministre des Affaires Etrangères David Cameron, déclare que « »Nous reconnaissons (…) les graves préoccupations soulevées quant à l’équité et au manque d’inclusivité des élections », et « nous regrettons que tous les partis n’aient pas été formellement autorisés à se présenter ».